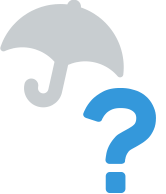Vos assurances de biens aux meilleurs prix
Assurance Auto
Tout véhicule motorisé se doit d’être assuré au minimum obligatoire en vigueur. La responsabilité civile, aussi appelée assurance au tiers, permet de couvrir les autres usagers en cas de sinistre responsable. C’est le niveau de garantie minimum pour assurer un véhicule.
Assurance Habitation
L’assurance Habitation, ou le contrat multirisques habitation (MRH), permet de protéger les murs, une partie du contenu ainsi que la responsabilité civile des occupants en cas de sinistre. Ce contrat propose de nombreuses garanties supplémentaires ainsi que la possibilité d’assurer une ou plusieurs annexes.
Nos clients donnent leur avis
Guides de l’assurance de biens
Nos classements des meilleures assurances de biens
Assureurs présentés par Bonne-Assurance.com